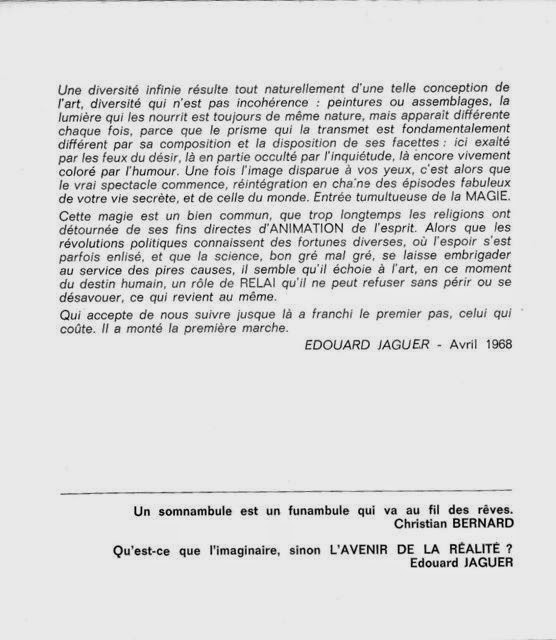|
| Le dieu vaudou Dhambala © Wifredo Lam dessin, 1979 |
Dans les premières pages de son Éloge de l’indifférence, Serge Sautreau nous apostrophait: “ Lecteurs, lecteurs, qui êtes tous peu ou prou écrivains, vous savez intuitivement qu’écrire est un acte au futur, une manière de sournoiserie pour converser, par le biais d’un étrange monologue, avec demain.” Nous voici donc devenus, aujourd’hui, ton demain, aussi peu assurés du nôtre que tu pouvais l’être du tien. Pour sans cesse différée qu’a pu être ton “indifférence”, la belle insolence de tes mots faisait le plus souvent mouche dans un coin de notre sensibilité, de notre pensée, de notre rire, sur le mode de la connivence sauvage, celle que tu pratiquais généralement avec les amis. Il m’est encore difficile, pour l’instant, d’écrire sur toi, je crois que je préférerais parler de toi, de Serge S., je préférerais te parler, mais, tu l’avais dit, “étrange monologue” désormais.
Au début des années 80, j’avais eu le pressentiment que quelque chose naissait, même si j’étais un peu seul à jeter certains types de ponts, j’avais appelé cela “une génération de l’ombre et de la lumière”; les veilleurs qui se dessinaient derrière la lampe avaient pour noms Petr Král, Serge Sautreau, Pierre Peuchmaurd, André Velter. Il y en avait quelques autres, je voulais maintenir la conjuration à la fois secrète et active, cela donna la collection Inactualité de l’orage. Le texte de Serge y fut publié en novembre 1981, le titre en était “L’Exactitude”, détournant avec ses mots à lui le bref encart de la collection: “Le peu de réalité d’un temps dont, apparences déjouées, nous ne sommes guère, voilà qui ne saurait nullement nous retenir de trouver en nous-mêmes la clé ouverte —le passe— de ses pseudo-verrous.”
 |
| © Antoni Taulé, dessin 1980 |
Au fil du temps, j’ai appris à découvrir les différentes vitesses d’écriture de l’ami Serge. Lui dont je connaissais surtout les fulgurances, l’écriture-coupure, coupante, j’ai découvert qu’il n’en était pas moins un amoureux du conte, du conte de la vie comme elle nous est si souvent refusée, mais c’est peu de dire qu’il avait, lui, pris les plus grandes distances avec la nécessité sociale, les blessures infligées par le principe politique de réalité. Ce que je veux dire par là, et je veux qu’on l’entende bien, c’est que Serge Sautreau était un poète absolu. Pas le genre d’homme à se plaindre, à jalouser qui que ce soit, à jouer les misanthropes ou les seigneurs de la réussite, même marginale, pas même le genre à affecter un dandysme quelconque; à tout cela je crois qu’il préférait la pêche métaphysique en eaux limpides, la vérité du coeur, la forge des mots en feu. Evidemment ce n’est pas avec des moyens comme ceux-là qu’on fait les poètes en vue, mais il ne m’a jamais dérangé personnellement que la poésie ait toujours un peu maille à partir avec l’invisible, voire avec une certaine invisibilité, ce qui est loin d’être la même chose.
Doué d’une conscience politique aiguë et, simultanément, d’une générosité de tempérament, il me semble que la vérité la plus profonde de l’homme était dans son souci de poésie. Je me souviens très bien d’une de ses formulations qui consistait à dire que le poète est au service de la poésie, et non l’inverse. Ce n’est pas d’humilité qu’il s’agit alors, mais de la plus grande ferveur : autant Serge n’avait guère de respect pour l’obligation sociale, autant il avait grand souci de son interlocuteur, et tout autant de l’expression poétique. L’heure n’est pas venue, en tout cas pour moi, de démêler l’écheveau de la trajectoire du poète et de sa poésie, mais j’ai tendance à penser que “l’effet guillotine” de ses mots ont été tempérés par sa prose que l’humour prenait un malin plaisir à prolonger comme s’il était dans l’essence d’une construction mentale de ne jamais finir.
 |
| Las Abalochas (détail) © Wifredo Lam, huile sur toile, 1970 |
Il y a pourtant des écritures, des rythmes, des précipités, des vertiges pris entre virgules qui ne s’oublient pas, qui s’impriment dans les nerfs au-delà du sens apparent. Serge Sautreau, dès le départ, pour moi c’était cela, des rapprochements et des brisures syntaxiques qui n’appartiennent qu’à lui, inventeur d’une logique métaphorique en perpétuelle émulation-destruction. Le fil se jette, déchirant l’air, il y a du courant, un magnétisme imprévu, une imprévisible magnésie, allez savoir ce que dit la poésie, si elle chante comme un bruit de torrent dans le silence, avant et après. Et pendant.
Le désir m’a repris d’édition séditieuse et semi-clandestine; c’est alors qu’a paru Rivière je vous prie (1997) à l’Atelier Le ciel sur la terre. J’y ai retrouvé, parfaitement insoumis, le ton qui m’était cher :
“L’arc-en-ciel a droit de chute sur les mousses, la maïeutique, le système nerveux et les plans d’eau béante au-delà des rapides.
Voici l’inentrevue, la veine de vie insomniant ses terres.
Rivière noire.
Rivière d’or.
Rivière d’avant loi.”
 |
| Rivière je vous prie par Serge Sautreau © atelier Le Ciel sur la Terre, hors commerce, 1997 |
A lire un texte comme celui-là, on se dit qu’il y a tout de même, dans notre pays, une invraisemblable censure économique, culturelle, morale pour qu’un poète de cette qualité ne trouve pas immédiatement un éditeur, de ceux qui ont pignon sur rue, et sont chargés de faire rayonner ce qui, déjà, rayonne. Puissent les pages qu’on lit dans ce cahier réparer l’outrage fait à la poésie, puisque, plus que jamais, il faut des poètes pour publier les poètes.
Et il est vrai, aussi, qu’en la poésie toujours quelque chose, ou plutôt quelqu’un, résiste. Serge n’était pas loin de penser que la réalité n’est que ce qu’elle mérite d’être. La question vaut justement d’être posée si tant est que les individus, spécialement les poètes, sont des faiseurs de réalité. L’imaginaire de chacun n’est pas une barricade mystérieuse, tous les secrets sensibles, tous les secrets sacrés sont partageables, il n’y a pas de limites à ce qu’un homme tente de dire, pas de frontières aux pays qu’il tente de fréquenter “car il n’y a pas de chemin à accomplir, ce chemin, de même que la cible, se trouvant inclus dans la flèche même et sa course.” (in Les aventures froides).
Serge Sautreau est mort le 18 mars 2010.
Le texte qu’on vient de lire est daté du 26 avril 2010.
Les illustrations d’Antoni Taulé et de Wifredo Lam sont extraites
du recueil de Serge S. intitulé ABALOCHAS, publié en 1981 chez Pierre Bordas et fils.
Pierre Vandrepote