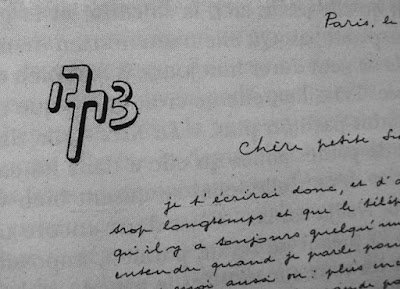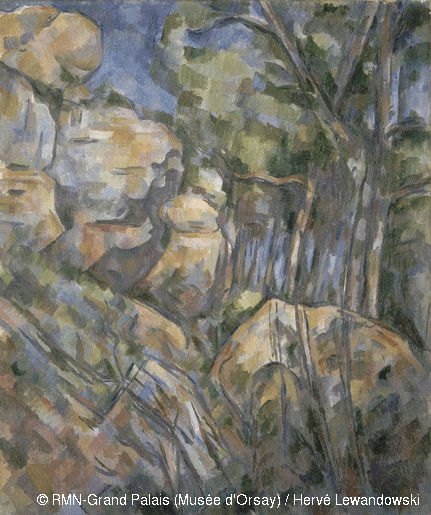|
| Fernando Pessoa |
Pourquoi ai-je souligné jadis, lors de ma première lecture du Livre de l’intranquillité, ce paragraphe où Fernando Pessoa parle de ces “malentendus” qui nous portent à croire que le réel ne saurait obéir qu’à une logique rassurante ? Voici ce qu’il écrit: “Nous attribuons généralement à nos idées sur l’inconnu la couleur de nos conceptions sur le connu: si nous appelons la mort un sommeil, c’est qu’elle ressemble, du dehors, à un sommeil; si nous appelons la mort une vie nouvelle, c’est qu’elle paraît être une chose différente de la vie. C’est par le jeu de ces petits malentendus avec le réel que nous construisons nos croyances, nos espoirs — et nous vivons de croûtes de pain baptisées gâteaux, comme font les enfants pauvres qui jouent à être heureux.”
Une certaine lucidité dévastatrice a souvent élu domicile chez le poète portugais, devenu célèbre dans toute l’Europe, bien après sa mort en 1935. Grand interrogateur de toutes les formes de pensée qui se télescopent en permanence en lui, Pessoa est de ces écrivains qui construisent leur oeuvre en déconstruisant méthodiquement l’inconscient même de notre perception du monde. Ne serait-ce pas, à proprement parler, le fonctionnement de la pensée qui conduirait naturellement l’homme à l’erreur ? Alors que nous croyons explorer une vérité du monde, nous ne faisons que projeter sur lui une croyance, une analogie, un “malentendu” qui nous éloignent toujours plus de l’objet qu’il s’agissait, initialement, de saisir. Tout langage humain ne saurait produire, en somme, autre chose que de “l’intranquillité”, fausse connaissance puisque métaphorique. L’homme et le monde sont ainsi condamnés à dialoguer jusqu’à la fin des temps sans jamais se rejoindre ni se comprendre. Le secret du monde ne serait alors pas celui de l’homme; la vérité de la poésie consisterait d’abord à ne pas nier cette terrible fatalité. Difficile, en effet, de ne pas voir en Pessoa le poète de la plus grande radicalité qu’ait pu nous donner le début du vingtième siècle. Outre qu’il a presque totalement échappé à la vigilance littéraire de son temps, son oeuvre aura longtemps existé sous la forme d’une désœuvre inconnue, d’une malle égarée par un voyageur dont le voyage n’était autre que lui-même. C’est d’ailleurs sous cette forme qu’elle ne cesse de nous parvenir encore aujourd’hui, morcelée, brisée, éclatée en une intense flânerie, inachevée, ouverte sur tous les avenirs que Pessoa pressentait illisibles, ce qui n’a pas manqué.
Il fut cet aide-comptable lisboète qui a poussé la pensée, le langage, la poésie dans ses ultimes retranchements; il a été, parmi les poètes, celui qui a le moins triché avec l’émotion, celui qui a sans pitié réfléchi sur ce qu’il y a de non-poète dans la condition de l’être humain. Assoiffé de justesse, épris d’absolu, il sait que plus il écrit, plus il produit de la séparation, de l’éloignement. L’œuvre parfaite n’aurait pu exister que dans le non-écrit. Écrire, c’est produire de l’imperfection, de l’inutile probablement, tenter de rattraper en soi l’illusion de ce qui voudrait être la belle et simple réalité, inaccessible.
Écrivant des milliers de pages, de notes, fragments, poèmes, essais, décrivant et déclinant à l’infini l’aléatoire de ses sensations, de ses contradictions jamais inconscientes, il ne cesse de faire l’apologie du non-écrivain qu’il est, de la non-écriture érigée en oeuvre d’art. A aucun moment il n’écrit affichant le désir d’être compris, et sa peur d’autrui est immense tant il lui faudrait dépenser d’énergie pour tenter de comprendre l’autre, lui qui contient déjà en lui-même un certain nombre d’hétéronymes dont il n’est pas forcément maître.
D’où vient pourtant ce sentiment qui s’impose vite à la lecture de quelques phrases ou vers de cet homme à la fois banal et original que, parlant de lui et exclusivement de lui, c’est de nous qu’il nous parle, nous renvoyant l’image de qui nous sommes sans trop le savoir, irréductibles au regard d’autrui comme au nôtre ? La seule écriture qui importe — en ces temps où on ne cesse de nous ennuyer avec d’indigentes “autofictions”— est celle qui reste liée, d’une manière ou d’une autre, au désir de connaissance. Cet homme qui marche dans les rues de Lisbonne est en train d’entamer une longue promenade qui l’entraînera à travers le vingtième siècle, dont il aura été longtemps le passant le plus invisible, porteur de songes apparemment discrets, mais dont les déflagrations pourraient bien se faire entendre de plus en plus clairement dans l’époque à venir. Le miracle de Pessoa n’est pas sans faire penser à celui de l’équilibriste; peut-être n’a-t-il pas fondé à lui seul une “modernité”, ce qui faisait néanmoins partie de son projet, mais n’ayant jamais “réussi” historiquement de son vivant, son image, sa présence occulte n’ont cessé de s’imposer comme l’expression d’une conscience libre, traversée malgré tout par les flux contradictoires de son temps — il ne saurait bien sûr en aller autrement —, comme si les interrogations à longue portée de l’action humaine agissaient sur et dans un espace relativement peu visible de l’histoire, de ses évolutions, de ses changements. Cet homme qui marche dans la rue pourrait tout aussi bien déambuler dans une rue de Saint-Germain-des-Prés, de Nantes, de Berlin ou de Prague, il est la déambulation même, le somnambule des rêves de plein jour, celui qui touche terre comme si la terre n’existait pas, en tout cas pas plus pas moins qu’Alberto Caeiro, Alvaro de Campos ou Ricardo Reis, autant de visages réels inventés par l’intranquille Fernando Pessoa.
C’est Armand Guibert qui a parlé d’homme-Protée à propos de ce “Gardeur de troupeaux” qui, évidemment, jamais n’en garda aucun; mais Protée lui-même a-t-il jamais gardé les troupeaux de phoques de son père Poséidon ? L’analogie avec le “vieillard de la mer” fonctionne d’autant mieux que celui-ci passait pour être doué de la rare faculté de prophétie et d’une grande propension à se métamorphoser au-delà même du règne animal ou végétal. Pessoa ou l’homme-univers, cela correspond assez bien à celui qui avait intériorisé à tel point le monde extérieur qu’il le ressentait en lui comme une sensation, une vérité ou réalité intérieure, en une sorte de monisme absolu qui lui a permis d’échapper à la folie de l’hyper-lucidité comme à la clairvoyance secrète de la folie. Car c’est là que se trouve l’enjeu crucial de la partie que joue Pessoa avec le monde, avec les autres, avec sa solitude. Il lui faut à tout prix briser l’antinomie du sujet et de l’objet, de l’un et de l’autre, de la prose et de la poésie, de l’immobilité et du voyage, de la parole et du silence, l’antinomie de toutes les pensées qui ne parviennent pas à se transformer en pensées sensibles.
Il faut imaginer le jeune Pessoa, il a alors vingt-six ans, il retiendra à jamais cette date, le 8 mars 1914, c’est le “jour triomphal” de sa vie, il n’en connaîtra pas un autre. Cette date est celle d’une double révélation qui se fait en lui, d’abord l’apparition “interne” de son maître Caeiro, ensuite la découverte de ce qu’il va nommer “L’effarante réalité des choses”. Le voilà bien aux antipodes de la pensée commune; le poète n’est pas là pour faire rêver, moins encore pour se faire rêver lui-même ou pour faire une belle carrière dans les mots. La poésie, c’est de la douleur gaie si vous voulez, c’est l’aventure de l’homme dans sa propre étrangeté, l’exploration d’un détachement qui ne cesse pas, qui ne se réduit pas. Ce n’est pas pour autant de la tristesse ou du malheur, du pessimisme ou un goût prononcé pour l’échec. La métaphore du “Gardeur de troupeaux” n’est ni vaine ni arbitraire; le poète est effectivement celui qui “garde” quelque chose, ce peut être la langue, ou la réalité, ou la sensation d’enfance, la multiplicité du réel et des sensations, celui qui “garde” la valeur des choses sans valeur, leur saveur, la bonté des choses lorsqu’on les laisse aller vers elles-mêmes sans tenter de les détourner par le langage. En fin de compte, la poésie veut faire naître l’impossible étincelle du bonheur, la rendre possible, comme si la vie devait être naturellement heureuse. Ce n’est pas une utopie, c’est simplement un chemin, un visage, une émotion, une force, une coïncidence, un hasard interprété. Ne pas croire que les contradictions s’opposent alors que les choses se réunissent toujours les unes aux autres. Pour que les objets existent, il est nécessaire qu’ils s’excluent les uns les autres. C’est ce qu’enseigne Caeiro le Païen, l’infini est contenu dans le fini, et non pas l’inverse. Supprimez l’homme, il resterait le desassossego des étoiles, des mondes qui tournent dans l’ennui d’une conscience perdue.
Se taire n’est pas si différent que se sentir condamné à l’écriture. Qu’est-ce que je saisis à travers l’écriture qui soit “moi”, qui soit le “monde” ? Et si je me tais, est-ce que le monde ne continue pas, sans moi, d’être ce qu’il est ? Suffit-il d’énoncer pour faire advenir, pour entrer par effraction dans la trompeuse épaisseur du réel ? Le langage est une danse où l’homme est un invité de passage. Sans doute quelque chose dure, résiste, mais il ne faut pas oublier l’oubli, la présence sans cause. Écris si tu veux, c’est toujours contre la mort que tu écris, c’est-à-dire pensant à elle malgré tout, pour elle sans le dire. La vie, la mort scellent le même destin, fatalement. L’écriture serait-elle l’épanchement de la vie réelle dans l’espace de la mort ? Et si Pessoa, à ses heures, continuait d’arpenter les rues de Lisbonne ? S’est-il aperçu de sa mort à travers la poésie sans fin interrogée, chaque jour ? Un homme est mort, mais son intranquillité agit, se glisse entre des pages, perturbe cet individu qui vient d’entrer au Bureau de tabac acheter un paquet de cigarettes. Et moi, qui ai lu jadis ce poème de Fernando Pessoa, je suis allé plus tard à Lisbonne où j’ai cherché la rue des Douradores sans la trouver; je sais que j’y retournerai un jour, parce que ce petit homme m’intrigue avec sa tranquille inquiétude.
 |
| prenant de ses nouvelles |
Lorsqu’on a tout vécu, que reste-t-il à vivre ? Lorsqu’on n’a rien vécu, que reste-t-il à écrire ? C’est dans cet espace intersticiel, minuscule et indéfini, que la question se pose à Bernardo Soares — celui des hétéronymes qui signera le Livre de l’intranquillité — de donner à sa vie la modestie du sens qui lui convient. Sans doute n’a-t-il rien de particulier à dire, c’est, somme toute, le lot de bien des gens qui écrivent. On peut penser que plus de quatre-cents pages environ devraient suffire à se faire une idée ! Notre homme commence pourtant par annoncer qu’il n’a pas de biographie, qu’à y réfléchir un peu rien n’a d’intérêt, qu’il n’y a rien à raconter. Il est tout juste prêt à concéder “Une acuité horrible de mes sensations, et la conscience profonde du fait même que je vis ces sensations... Une intelligence aiguë utilisée à me détruire, et une puissance de rêve avide de me distraire...”
Quoi qu’il en ait, le fait même d’écrire, sa nécessité biologique constitue pour Pessoa le suprême mystère. Et la plus grande contradiction. Lui qui ne cesse de répéter qu’il suffit d’exister pour sentir l’être, de “voir” pour sentir l’existence abrupte de toutes choses, immanquablement il se laisse aller à la “prose” de ses vers, redoublant la vue par la trace noire et blanche sur le papier, vivant la vie par le dit de la vie, l’énonçant infiniment en un murmure clair, presque transparent. Pourrait-on le croire, rien ne compte pour lui que son œuvre; lui qui est si dépourvu du sens de l’unicité de son moi épouse, ou voudrait épouser rien moins que la totalité de l’existant. Il croit, sans le dire, à son œuvre, à sa présence au monde, mais plus encore peut-être à son effacement, à sa dissolution dans une impermanence sans nom. Il écrit dans sa solitude-monde, au beau milieu de ses hétéronymes dont il est à la fois le créateur et le disciple; il a en premier lieu le sentiment de n’être rien, mais il ne saurait être rien; respirer l’air du monde c’est déjà en participer, c’est déjà devenir monde. Se tenir debout ici, marcher dans cette rue où on est forcément seul et multiple, c’est au minimum entrer dans le décor de soi-même; et c’est ainsi que Pessoa joue sur la scène du théâtre de sa vie, il rêve les yeux ouverts dans une réalité qui lui paraît avoir les yeux fermés. Mais il ne faut pas oublier non plus qu’il ne jouit pas des appuis des Grands de ce monde qui pourraient lui permettre de se construire une stature intellectuelle, il est un de ces “rêveurs définitifs” pour qui se perdre ou se trouver n’est pas une antinomie pertinente. A l’opposé sensible d’un Rimbaud, il encourt exactement le même risque, celui de n’être jamais connu, reconnu. Sans nom et solitaire, il peut tout aussi bien sombrer dans l’oubli, c’est-à-dire, d’une certaine façon, ne pas être. Quelque chose le pousse néanmoins à penser que son être personnel est pétri de particulier et d’universel, que Pessoa n’est pas tout entier réductible à Pessoa. S’il y a du génie individuel en lui, il n’en tire que la vanité ambiguë qui s’attache au double sens de ce mot.
Pessoa, c’est Personne. Ce n’est pas un simple jeu de mots, d’ailleurs limpide en portugais. Ce sont les mots, tels qu’ils sont, tels qu’ils jouent à l’infini les uns avec les autres; ce ne sont pas seulement les mots, ce sont justement les choses, le sentiment exacerbé des choses. Nous ne sommes plus dans la “correspondance” baudelairienne, nous sommes dans le monde halluciné par une conscience ou la sensation d’extériorité et celle d’intériorité ne sont plus dissociables. “Je suis les faubourgs d’une ville qui n’existe pas, le commentaire prolixe d’un livre que nul n’a jamais écrit.” Et d’ajouter :”Et moi, ce qui est réellement moi, je suis le centre de tout cela, un centre qui n’existe pas, si ce n’est par une géométrie de l’abîme...”
Il semble que Pessoa ait été le lieu d’une singularité tout à fait spéciale dans le domaine de la perception. La “sensation” du réel qu’il éprouve ne fait qu’un avec l’écho du “sentiment” que cela provoque en lui via la perception intellectuelle et visuelle. Là où Rimbaud disait “Ce sont des villes...”, notre commentateur halluciné dit “Je suis les faubourgs d’une ville...” La fusion entre sujet et objet est telle que le moi de l’individu est comme suspendu, envahi par l’objet qui vient occuper toute la place. L’originalité est de taille pour un écrivain, voire pour un poète. Si la fin du dix-neuvième siècle a vu naître le poème en prose, Pessoa n’hésite pas à inventer une poésie démonstrative, d’essence prosaïque, qui porte moins l’esprit vers les espaces du rêve que vers ceux d’une “connaissance” peu situable, mais qui a le mérite de ne guère laisser en repos notre perception du monde. Le texte de Pessoa, au lieu de se déployer comme souvent chez les poètes dans l’espace métaphorique, tend à l’identification brute, non analogique. La conscience de l’auteur est douée d’une perméabilité immédiate telle qu’il perçoit le monde extérieur comme un faisceau de simultanéités, au risque de s’y dissoudre. Au fond, Pessoa n’est “personne” parce qu’il a le sentiment d’être le monde entier, il n’a pas d’identité parce qu’il est trop plein de tout ce qui existe, et cette réalité qui l’emplit lui devient rêve. Un rêve sans fin, proche et insaisissable, qui le hante sans l’apaiser, délire qui lui permet de vivre, d’accepter la vie.
En même temps, ce délire peut parfois l’entraîner vers des zones dangereuses. L’irruption du coursier dans le bureau d’à côté peut le surprendre si brutalement que la situation anodine se transforme soudain en lui en épreuve inacceptable. Le voici gonflé de haine pour l’intrus : “Il me sourit du fond de la pièce, et me dit bonjour à voix haute. Je le hais comme l’univers entier.” Haine de l’autre, haine de soi, phase que chacun connaît et traverse; le plus souvent, c’est plutôt une sorte de neutre compassion que l’humanité lui inspire. De cette humanité, Pessoa ne s’exclut pas, bien au contraire. Aucun sentiment psychologique de supériorité chez lui. La seule chose qu’il sait, c’est que dans la rue il dort sans dormir, il rêve sans rêver, il navigue vers l’impossible sans cesser de ressembler à tout un chacun. En fait, lorsqu’il écrit, il invente le monde presque sans le savoir. Du fond de la dépression chronique qui ne le quittera pas, il forge le visage d’une modernité qui se cherche, qui remet en question les valeurs d’un monde ancien fermé sur lui-même. L’unité éclate dans la conscience de Pessoa comme le monde est en train d’éclater à l’extérieur. L’idéalisme qui prévalait jusqu’à la fin du dix-neuvième siècle cède du terrain à l’industrialisation des techniques, au “matiérisme” de la pensée éclatée, Illuminations rimbaldiennes d’un côté, voyages apparemment immobiles dans la pensée en bribes de l’imaginaire pessoen, de l’autre.
En Pessoa, ce sont les consciences classique, romantique, et même symboliste qui explosent. Les genres littéraires ne fonctionnent plus à la manière des indicateurs habituels; la métaphysique est retournée comme un gant, faisant procéder le sentiment de l’infini de l’aspect fini de toute sensation. Pessoa marche dans l’ombre de son siècle, il est un écrivain dont l’œuvre n’a pas pour but d’être constituée, ni aujourd’hui ni demain; il est lui-même cette marche dans la marche, celle d’un inconnu bouleversé par un intense sentiment de la vie. Poète sans poésie, quidam de l’âme et du macadam de Lisbonne, prophète sans prophétie, ne prédisant aucun futur, rêvant le présent sans vraiment le toucher. Épuisé, Pessoa, comme si le monde, demain, allait mourir en lui. Inépuisable, pourtant.
à travers le temps
Pierre Vandrepote